L'ambiguïté du titre français, Mort sur le Nil, est la première question que pose ce célèbre roman policier d'Agatha Christie, dénouée par le titre anglais, Death on the Nile (1) : il s’agit de la mort et non d’un mort sur le Nil. Car il y a plusieurs morts dans ce roman qui aurait pu être intitulé Deux mariages et cinq enterrements.
Le roman ne commence pas par un crime ou par un cadavre dont il va falloir dénouer l'histoire et trouver le responsable. Le crime ne survient qu'après le premier tiers du roman et constitue la première énigme que pour le lecteur : qui va mourir dans cet échantillon de la bonne société, essentiellement, britannique, où tout le monde se connaît ou presque, en croisière touristique sur le Nil ?
Question peut-être inopportune car Agatha Christie s’étend largement sur la description d’une personne, la seule personnalité exceptionnelle qui attire tous les regards, admiration, jalousie, rancune qui la désignent au lecteur comme la probable victime.
Elle est la première dans l’ordre d’apparition des dix-huit personnages présentés dont cinq ne seront pas de la croisière et ne peuvent être ni la victime, ni le coupable et Hercule Poirot, le célèbre détective. Cela réduit, pour le lecteur, le nombre de suspects à douze. Il est difficile de penser que les rôles principaux, victime ou coupable, puissent ne pas apparaître dans cette première liste et se trouver parmi les six croisiéristes découverts par la suite. Le lecteur est en droit de penser qu’ils ne sont que des personnages secondaires par leur rang ou leur nationalité dont un policier, confident et auxiliaire d’Hercule Poirot, une victime collatérale comme on dit aujourd’hui, un archéologue italien, un aristocrate original et incognito… comparses éventuels ? Leurres pour le lecteur ? En oubliant, bien sûr, le personnel qui se résume à quelques stewards anonymes et un Nubien...
Cette personne est exceptionnelle par sa beauté, son élégance, sa richesse, son intelligence mais aussi par son inconsciente suffisance pleine de bonne volonté. En un mot, la perfection d'une jeune femme de son rang en fait la victime annoncée. D’autant que de nombreux compagnons de croisière souffrent de cette altière supériorité et ont quelques motifs plus ou moins légitimes de lui en vouloir, possibles mobiles d’un passage à l’acte.
Le crime commis, la victime connue, reste à trouver parmi les mobiles suggérés par l’auteur lequel a poussé à commettre l’acte meurtrier.
La seule présentation des personnages, dans leur milieu au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis ou en croisière, fournit à Hercule Poirot et au lecteur, de nombreux indices qui orientent vers la victime d’abord, les coupables ensuite. Indices dont la collecte commence donc avant le crime, avant l’enquête.
Au total, une dizaine de britanniques semblent être les seuls passagers de la croisière, pouvant prétendre à la culpabilité. Quelques autres personnes participent à la croisière mais sont indignes de tout soupçon, par leur condition ou leur nationalité : une infirmière française, un archéologue italien, un lord original incognito et tout le personnel qui se résume à quelques stewards anonymes et un Nubien..
C’est seulement parmi les personnes de cette haute société impériale, dignes d’attention, que se trouve le ou les coupables. Car chacun, au dessus de tout soupçon, est dans une situation, plus ou moins douteuse, susceptible de l’entraîner à des actes gravissimes : un prétendant délaissé, un noble ami humilié, ils ne font pas partie de la croisière. Restent une amie dont le fiancé a été détourné, un membre d’une vieille famille ruinée par des manœuvres financières du père de la victime, des gestionnaires douteux de sa fortune, un voleur de bijoux surpris dans son activité, un amoureux indélicat contrarié par une intervention intempestive, une kleptomane ou une alcoolique, malencontreusement démasquées... Ces différentes raisons d’importance inégale touchent des personne plus ou moins aptes à commettre un acte d’une telle gravité…
Le premier mobile, de toute évidence, dans le classique trio amoureux, est la fiancée délaissée qui en fait la première suspecte. Elle n’hésite d’ailleurs pas à provoquer, à montrer son revolver, à crier son amour-haine...
Mais cette évidence est trop simple
Heureusement, Hercule Poirot est à bord. Grâce au hasard, à sa mémoire exceptionnelle, un repas à Londres quelques mois auparavant, à un excellent don d’observation, à une grande finesse psychologique, à sa perspicacité, à ses intuitions, à sa réputation qui en fait le confident des uns et des autres, le célèbre détective va dénouer le problème. Avec cependant deux meurtres supplémentaires qui font progresser l’action. Et deux autres morts violentes à l’arrivée de la croisière qui la concluent. Le titre du roman aurait pu être Deux mariages et cinq enterrements. Car il n’y a pas lors de cette croisière que des meurtres.
Hercule Poirot est assisté du colonel Race qui recherche mollement et trouve fortuitement, un tueur à la solde de rebelles d’Afrique du Sud. Il joue aussi un rôle de confident, de faire-valoir…
Deux policiers du même monde, hommes justes et généreux, qui se plaisent à faire œuvre de justice en respectant sinon la loi du moins l’ordre : ici, tous les délits sont tenus secrets, sauf les assassinats. Ils sauvent ainsi les apparences d’une société qui ne doit pas faillir, qui doit paraître. Et la croisière finit heureusement par deux unions. Quand Race reconnaît logiquement : De fait, ce mariage a été réglé par le Ciel et Hercule Poirot. Celui-ci réplique avec son humour et sa vanité légendaires : Non, cette histoire a été tout entière imaginée par moi. C'est à dire, plus justement, imaginée par Agatha Christie.
Quant aux morts collatérales en cours d’enquête, Dieu ou Diable n'ont pas eu besoin d'aide.
Le nœud, le leurre du drame est dans le classique trio passionnel. Et Agatha Christie s’ingénie à faire progresser l’enquête en éliminant les différentes hypothèses qu’elle a suggérées au lecteur, notamment à travers les confidences d’Hercule Poirot à Race.
Dans un rapport d’étape approuvé par Hercule Poirot, Race dresse la liste de ceux qui ont des mobiles plausibles contre lesquels nous possédons des témoignages certains (six personnes), et ceux qui, à notre connaissance, sont libres de tout soupçon (huit personnes). Curieusement, il ne cite ni dans un groupe, ni dans l’autre, ni dans un troisième, deux membres du classique trio. Façon de les faire oublier du lecteur...
Les unes sont soupçonnées à cause de motivations qui paraissent un peu légères, découvertes de l’alcoolisme caché d’une vieille femme, kleptomanie d’une autre que son infirmière personnelle surveille... D‘autres sont plus ou moins suspects à la suite de déclarations mensongères en contradiction avec d’autres témoignages, visant à cacher des choses plus graves… D’autres enfin paraissent difficilement coupables car n’ayant jamais échappé au regard des uns ou des autres surtout après un tir apparemment passionnel de la fiancée délaissée sur celui qui l’a abandonnée pour son ancienne meilleure amie. Ou une suspecte elle-même assassinée !
Il ne reste plus à Hercule Poirot qu’à faire étalage de son don d’observation des faits comme des sentiments et de relier des indices qui conduisent à confondre les coupables.
Ce qui paraît alors évident au lecteur.
1 - Mort sur le Nil (Death on the Nile) de Agatha Christie, Librairie des Champs-Élysées, 1948, 254 p.
commenter cet article …







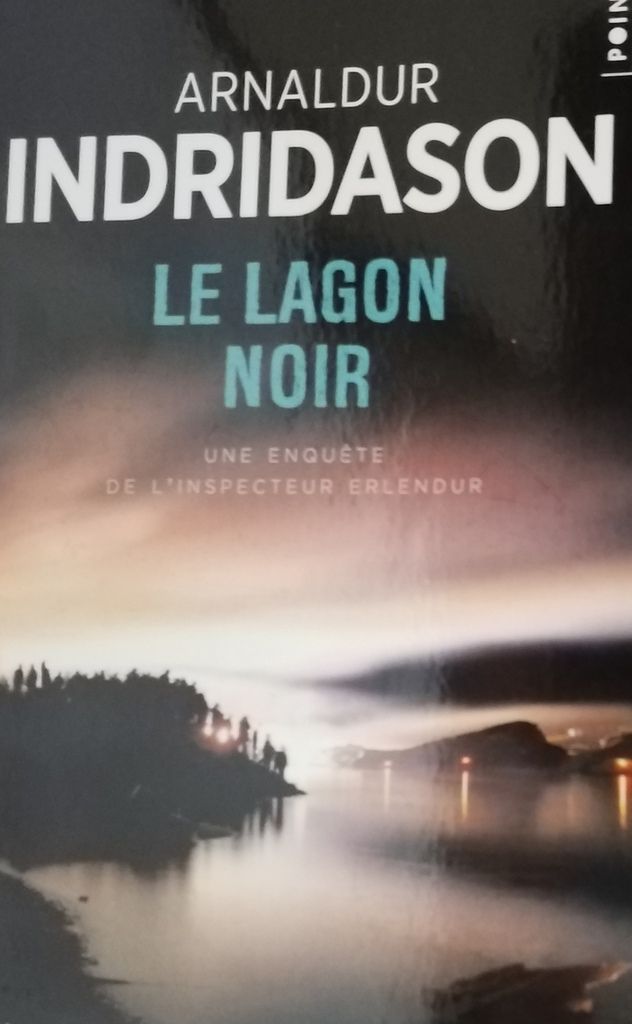
















 Kamel Daoud, Maghreb des livres, 07/02/15
Kamel Daoud, Maghreb des livres, 07/02/15 On peut très bien admettre qu'Alain Finkielkraut et Alain Vircondelet n'aiment pas « L’Étranger » de Camus. Mais considérer que son succès ne tient qu'à l'obligation qu'avaient les lycéens d'une certaine époque de l'étudier en classe... Encore un complot des enseignants et de l’Éducation nationale !
On peut très bien admettre qu'Alain Finkielkraut et Alain Vircondelet n'aiment pas « L’Étranger » de Camus. Mais considérer que son succès ne tient qu'à l'obligation qu'avaient les lycéens d'une certaine époque de l'étudier en classe... Encore un complot des enseignants et de l’Éducation nationale ! Jean-Pierre El Kabbach dans «
Jean-Pierre El Kabbach dans « /image%2F1506212%2F20190612%2Fob_c79b69_roubaix-piscine-114647.jpg)